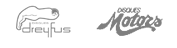C’est avec stupéfaction et une pointe d’incrédulité que le petit monde du jazz hexagonal accueillit en 2001 la parution de « Luggage », premier album sur le label Dreyfus Jazz d’un jeune saxophoniste italien de 34 ans, confondant de fougue et de maîtrise mêlées. Qui pouvait bien être ce Rosario Giuliani, revisitant de façon aussi personnelle et talentueuse l’héritage coltranien au prisme du néo hard bop le plus contemporain ? Etait-il encore possible, en ce début de millénaire, de surgir ainsi « de nulle part » et d’affirmer avec autant d’autorité un discours à ce point cohérent et séduisant ?
On prit alors la peine de jeter un coup d’œil au-delà des Alpes pour se renseigner. On s’avisa d’abord que “Luggage“ était loin d’être son premier disque mais déjà le 5e… Et l’on découvrit finalement que ce jeune prodige du saxophone alto était dans son pays tout sauf un inconnu.
Partenaire depuis le tournant des années 90 des plus grands noms du jazz américains de passage comme Kenny Wheeler, Randy Brecker, Bob Mintzer ou Cedar Walton; collaborateur régulier du légendaire pianiste Franco d’Andrea (guest star sur ses deux premiers albums : « Live from Virginia Ranch » et « Duets for Trane ») ; lauréat en 1996 du prestigieux Prix Massimo Urbani récompensant chaque année le meilleur saxophoniste alto italien ; leader dans la foulée de son propre quartet composé de quelques uns des plus talentueux jeunes musiciens de la péninsule comme le pianiste Pietro Lussu — Rosario Giuliani s’avérait décidément moins le « produit de synthèse high tech » que certains avaient cru bon de dénoncer qu’un authentique musicien de jazz « à l’ancienne », détenteur d’un savoir faire et d’une connaissance intime de l’idiome jazz acquis sur le terrain et au fil des années, dans un corps à corps toujours recommencé avec la musique.
L’extraordinaire écho critique qui accompagna la sortie de “Luggage“, apporta immédiatement une nouvelle renommée internationale au jeune saxophoniste mais ne modifia en rien son attitude vis à vis de la musique. Les quatre disques qu’il fit paraître à la suite dans la décennie qui suivit, toujours sur le label Dreyfus Jazz, en sont la preuve magistrale, qui tous proposent un même mélange subtil de sophistication formelle et d’authenticité émotionnelle, leur conférant ce supplément d’âme qui fait la différence. “Mr Dodo“ (2002), “More Than Ever“ (2005), “Anything Else (2007) et « Lennies Pennies“ (2011), apparaissent ainsi avec le recul comme autant d’œuvres exigeantes sous leur séduction apparente, marquant chaque fois une nouvelle étape décisive dans cette quête intime de perfection dans laquelle Rosario Giuliani semble s’être engagé corps et âme. Car sans jamais rien abandonner de sa verve lyrique, de sa fougue ni de son ineffable énergie qui font tout le charme de sa musique extravertie, Giuliani n’a de fait jamais cessé, au cours de ces dernières années, d’approfondir sa poétique et d’affiner son style, qui s’il demeure toujours profondément marqué par l’influence majeure de John Coltrane s’ouvre désormais résolument à d’autres types de modernité (d’Ornette Coleman à Wayne Shorter en passant par Lennie Tristano).
Plus que jamais éblouissant dans l’expression de ses moyens techniques, mais riche désormais de cette nouvelle maturité artistique, Rosario Giuliani franchit aujourd’hui incontestablement une nouvelle étape en signant avec “Images“ son disque assurément le plus intimiste et personnel.
Car cet album dont il a composé la quasi majorité du répertoire (seul le thème “Light At Night“ est de la plume du talentueux pianiste milanais Roberto Tarenzi), Rosario l’a conçu, pensé et réalisé à la manière d’un journal intime, d’une sorte de carnet de route émotionnel traduisant en musique une série d’impressions instantanées liées à des moments particuliers de son existence pour les agencer à la manière d’un voyage lyrique et introspectif étonnamment profond et émouvant.
A la tête d’un quintet extraordinaire de fluidité, propulsé par une rythmique de rêve composée de John Patitucci à la contrebasse (l’indispensable partenaire de Chick Corea et Wayne Shorter) et de Joe La Barbera à la batterie (l’ultime compagnon de route du grand Bill Evans) et ponctué des couleurs impressionnistes du vibraphone de Loe Locke, Rosario Giuliani y invente une musique à la fois réflexive et projective, mélancolique et solaire, explorant avec énormément de virtuosité et d’inventivité, des territoires idiomatiques mouvants et très peu empruntés, invitant la ballade modale d’inspiration post-coltranienne à venir s’alanguir à l’extrême décontraction d’une sorte de néo-classicisme west-coast subtilement resongé.
Déclinant toute la gamme des émotions à travers sa maîtrise technique superlative, son sens du swing implacable, et cette façon naturelle, très intuitive, d'aborder la mélodie, de la modeler de sa sonorité légèrement pincée, pour la magnifier en variations sinueuses, toujours surprenantes et inventives ; affirmant avec toujours plus d’autorité ses affinités électives avec les grands poètes lyriques de l’instrument, Jacky Mc Lean, Art Pepper, Massimo Urbani, références sans cesse évoquées et magnifiquement célébrées — Rosario Giuliani, à 45 ans, s’impose ici définitivement comme l’un des plus grands saxophonistes apparus sur la scène jazz ces vingt dernières années.